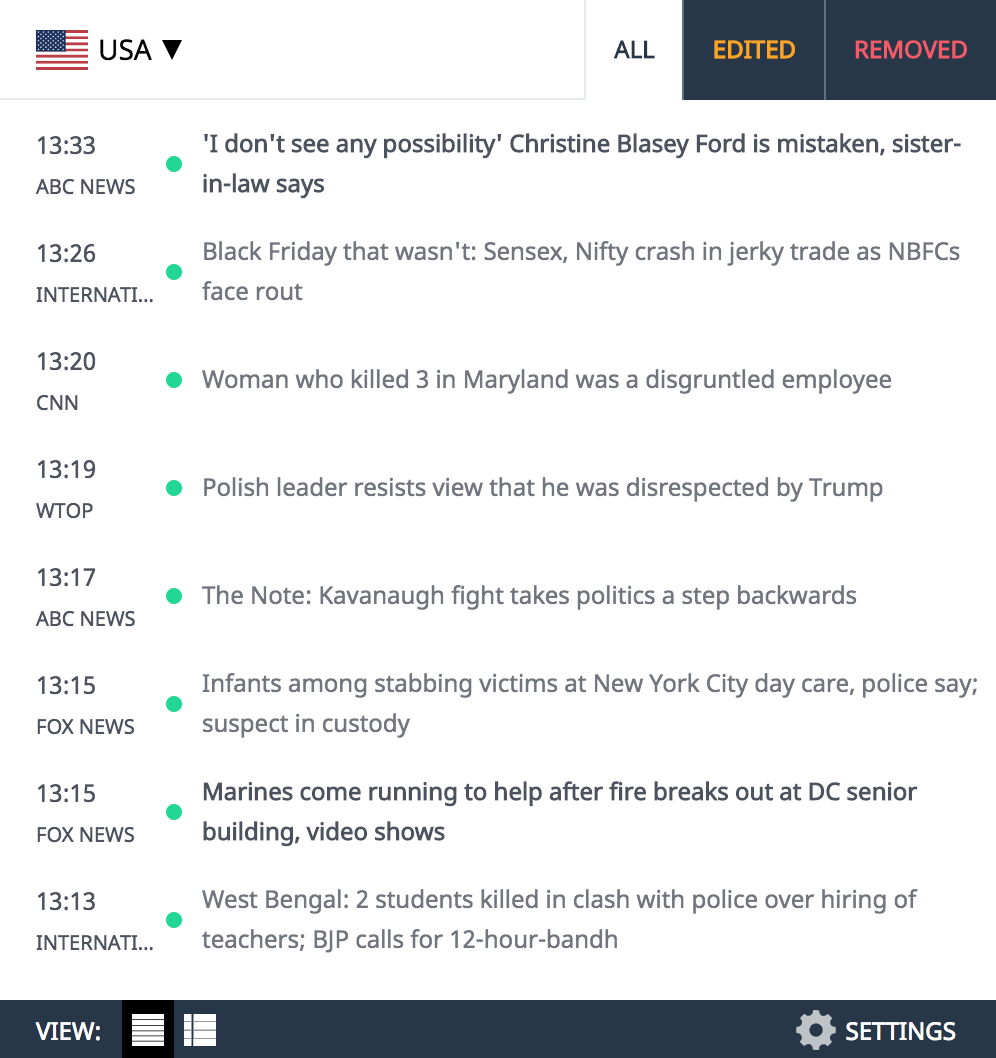Au Liban, une photo a fait le tour des médias. Celle qui immortalise une rencontre à Beyrouth entre le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, et le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri. Plus discret, un quatrième allié est également présent, mais n’est accoudé à aucun fauteuil. La réunion se passe pourtant sous son égide et son regard. L’Iran, figuré au centre du cliché par les portraits surplombants de deux ayatollahs, est à l’œuvre dans le nouveau conflit qui éclate au Proche-Orient. A cette heure, jamais le Liban n’a été aussi proche de replonger dans une guerre. Le Hezbollah, allié du Hamas, multiplie les actions à la frontière pour faire pression sur l’armée israélienne. Un jeu dangereux qui, à l’échelle du Liban, chamboule déjà la société tout entière.
«On ne comprendra jamais ce que je vais raconter, si on n’essaie pas de se mettre à ma place», confie Ali, 28 ans, dans les quartiers sud de Beyrouth. Quand on lui demande de se décrire, il se dit Libanais, «originaire du Sud Liban, c’est important». Il se présente comme infirmier à l’hôpital public, «donc pas très riche, il faut préciser». Chiite ? «Bof, je ne suis pas croyant.» Partisan ? «Je ne vote pas, mais j’ai chanté les slogans anti-milices pendant la révolution en 2019.» Ali a grandi près du village de Beit Lif, a connu la guerre en 2006 qui opposait déjà le Hezbollah aux Israéliens. Il dit aspirer dans l’idéal à un Etat en paix, laïque, et démocratique. «Mais demain, s’il y a une guerre, je soutiendrai la résistance du Hezbollah.»
«Etre Libanais, ça n’existe pas»
Son discours raconte une complexe mutation en cours dans la société libanaise. «Je ne pense pas que le Hezbollah soit fautif si un front s’ouvre, développe le jeune homme, car je suis certain que quand Israël aura rasé Gaza, ils s’attaqueront au Liban par prévention, sans se soucier des civils. Alors on doit se battre pour qu’ils n’entrent pas à Gaza, et montrer que le Liban sait se défendre.» Chaque jour, Ali est tantôt révolté, tantôt angoissé par les images qu’il reçoit de Gaza : les visages écarlates des enfants couverts de sang, ceux des bébés empoussiérés sortis des décombres. Les victimes lui ressemblent, sanglotent dans sa langue. «J’ai les craintes d’un habitant du Sud. A valeurs égales, un type des quartiers chrétiens dira autre chose. On n’a pas les mêmes perspectives, la même histoire, les mêmes intérêts. Car être Libanais, ça n’existe pas.»
Au nord de l’appartement d’Ali, où habitent les «types des quartiers chrétiens», les images des frappes israéliennes à Gaza ont aussi marqué les esprits. «On a déjà préparé des valises, au cas où, commente Zakye, mère de famille. Cette guerre n’est pas la nôtre, on n’est ni pro-Hezbollah ni israéliens… On nous impose encore un conflit dont le pays n’a pas besoin.» Dans son quartier acquis aux Forces libanaises (FL), ce parti chrétien hérité – comme tous les autres – d’une milice de la guerre civile vient de hisser ses drapeaux le long des grandes rues. Façon de rappeler qui est encore maître ici. Le parti tente de répondre aux craintes de ses partisans tout en conservant sa rhétorique d’opposition à la milice chiite.
«On a peur que cela se termine mal, ajoute Zakye. On voit réapparaître de vieux clivages.» Ces derniers sont ceux qui polarisent historiquement la «gauche» et la «droite» libanaise. Il y a quarante ans, la guerre civile, avant d’être un conflit rendu confessionnel par les milices, était surtout politique. Leurs positions sur la question panarabe ou palestinienne réunissaient ainsi, dans les rangs des pro-Palestiniens, des formations comme le Hezbollah, les communistes, les pro-Syriens… Des formations dont les étendards se sont encore mêlés, le 18 octobre, devant l’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth, comme l’écho d’un vieux clivage duquel le spectre politique libanais ne se défait pas.
«J’espère vite rentrer chez moi»
A 20 kilomètres de la frontière sud, l’institut technique de Tyr a fermé ses portes aux élèves et les a ouvertes aux déplacés. Depuis deux semaines, des milliers d’habitants du Sud ont fui, et parfois atterri dans ces centres d’accueil de fortune. Quelques matelas sur le sol, des stocks de bouteilles entreposées sur les tables d’écoliers. «On manque de tout ici, j’espère vite rentrer chez moi», balbutie Zahra, épuisée. Sa famille est partie à la hâte du village de Dhayra, alors que des bombardements menaçaient leur maison. Près d’elle, sur le seul vrai lit du rez-de-chaussée, est installée sa mère de 88 ans. «Elle est très malade et ne supporte pas les déplacements.» Recroquevillée, le visage étouffé dans les creux d’épaisses rides, l’octogénaire parle à peine. Elle ne peut plus marcher, alors le mari de Zahra a bricolé à côté du lit des toilettes avec une vieille chaise roulante et une bassine. Il soupire. Pas le temps de bavarder politique ou géopolitique : «On espère que d’ici une semaine ou deux, les choses se calmeront.»
Dans le couloir, Wafa, la quarantaine, s’inquiète et s’ennuie. Avec sa sœur, elles font défiler sur un vieux smartphone les photos de leurs deux chiens laissés au village. «J’espère qu’ils sont encore en vie. Tant pis s’ils détruisent la maison, j’espère au moins les retrouver.» Dehors, les gamins jouent au football. Ils entendent les adultes évoquer le Hezbollah, Israël, des bombardements… Dans le refuge de Tyr, tout le monde s’accroche à l’espoir d’une désescalade. Dans les esprits, la guerre arrive déjà, et peu importe qui soutenir, tant qu’elle se termine vite.