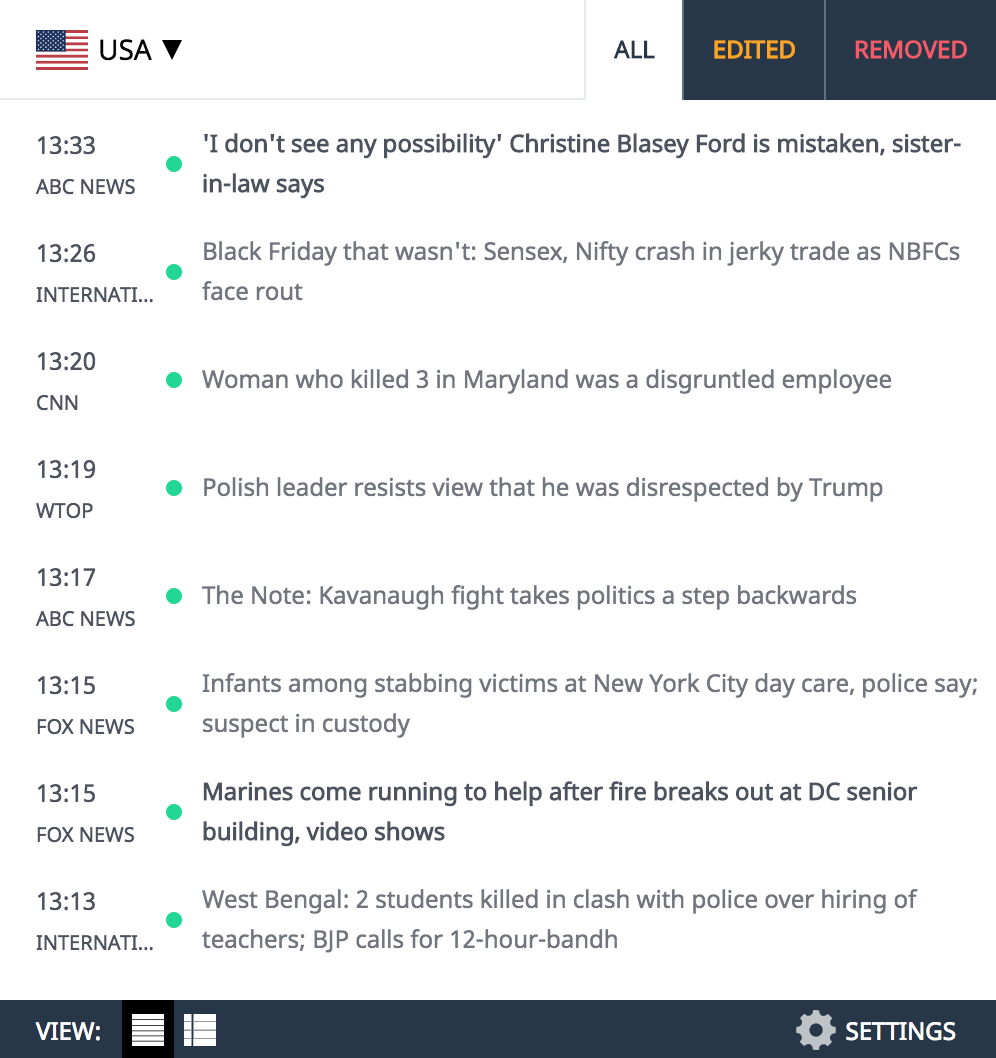Comment parler d’un dialogue de cultures quand des civilisations entières restent négligées dans l’espace globalisé de la création contemporaine ? Très peu connaissent le nom de Sayed Haider Raza (1922-2016). Pourtant l’artiste indien est reconnu comme l’un des plus grands peintres modernes, il faisait partie de l’École de Paris et a vécu pendant des décennies en France. Le Centre Pompidou-Paris lui consacre enfin la première grande rétrospective en France, avec une centaine d’œuvres, dont la plupart issues de collections indiennes. Entretien avec Catherine David, conservatrice générale des musées de France et commissaire de l’exposition.
RFI : Raza, fils d'un père forestier, est né en 1922 à Barbaria, au milieu des forêts de l’Inde centrale, avant de se former à la peinture à la J. J. School of Arts et de s’installer à Bombay, puis à Paris. En quoi consiste pour vous la particularité de l’artiste ?
Raza est un artiste moderne indien très important. Il a cette particularité d’appartenir à une génération extrêmement voyageuse. Il a vécu et travaillé plus de cinquante ans en France. Il est rentré en Inde en 2011. Cette exposition n’est pas la première exposition montée en France, mais c’est la première exposition rétrospective dans un grand musée. Ce qui interroge quand même notre relation aux artistes non euro-américains qui ont vécu et travaillé dans notre beau pays.
Raza est connu pour avoir été membre du Progressive Artists’ Group en Inde et de l’École de Paris en France. Il était le premier étranger à recevoir le prix de la Critique, à Paris, en 1956. Pourquoi est-il considéré comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle ?
En Inde, Raza est définitivement considéré comme l’un des grands maîtres de l’art moderne. Mais aussi en France et aux États-Unis. Il suffit de regarder l’état de son œuvre sur les marchés de l’art. C’est un peintre extrêmement bien côté, très demandé, et cela pas seulement en Inde. Pourquoi ? Il est identifié comme un grand peintre moderne par l’utilisation de l’abstraction, par le développement de gammes colorées extrêmement virtuoses et très contrastées qui renvoient à la tradition de l’emploi des couleurs en Inde. Donc, c’est un artiste de transaction relativement aisée entre le monde euro-américain et le monde indien. Pour les Européens, c’est un peintre qui utilise des formes identifiables et reconnues, valorisées, avec des gammes de couleurs qui ne sont pas tout à fait celles de l’École de Paris. Et pour les Indiens, c’est un artiste d’autant plus intéressant et important, parce qu’il a vécu en Europe, s’est frotté à l’avant-garde, même si c’était plutôt la fin de Paris comme capitale de l’avant-garde.
L’exposition commence avec une photo de 1947/48 où l’on voit Raza, à l’âge de 25 ans, dans son atelier à Bombay. Où se trouve-t-il à ce moment-là dans sa démarche artistique ?
C’est une très belle photo, prise dans un atelier qui produisait des calendriers. Il a beaucoup travaillé à faire des paysages à l’aquarelle, certains sont exposés à côté de la photo. C’est une pratique aquarelliste que les Indiens ont héritée des Anglais en y mettant une patte qui vient de l’art de la miniature du Rajasthan du XVIIe au XIXe siècle et d’autres pratiques picturales. Né dans le Madhya Pradesh [un État indien qui était à l’époque une province de la colonie britannique des Indes, NDLR], pour Raza, la capitale culturelle Bombay est une étape importante. Au début de sa vie d’artiste, il travaille aussi pour des productions commerciales avec des aquarelles, des paysages indiens produits pour des carnets et des calendriers distribués et vendus par des entreprises industrielles.
Il est cofondateur du Progressive Artists’ Group en 1947. Quelle était l’ambition de ce groupe d’artistes indiens qui souhaitaient trouver de nouvelles formes d’expression artistique après l’indépendance de l’Inde ?
Au début, il y a ces trois artistes qu’on voit sur la photo : Maqbool Fida Husain, Francis Newton Souza et Sayed Haider Raza. Après, cela s’est élargi très vite. Il y avait différentes vagues qui ont mis d’autres artistes autour du groupe fondateur. Selon Ranjit Hoskote, un poète et critique indien très important, le Progressive Artists’ Group était plus un moment qu’un mouvement. C’est-à-dire des artistes se rassemblent à un certain moment pour avoir une autre visibilité, pour présenter leur travail autrement. Mais quand vous regardez, ce sont des œuvres très différentes. On ne va jamais confondre un Raza avec un Souza ou un Husain. Et c’est un moment qui va rapidement filocher. Raza part à Paris. Soza part à Londres, Hussain va rester en Inde et devenir le grand peintre d’histoire moderne. Après, ce fameux Progressiv Artists’ Group n’est plus un groupe…
Qu’est-ce qui a provoqué son départ pour Paris en 1950 ? Est-ce l’attirance pour l’École de Paris et le dynamisme artistique de la capitale française ou plutôt l’attirance pour la pratique du nu qui était interdite en Inde ?
Il y avait plusieurs de ces raisons évoquées. D’abord, Raza avait obtenu une bourse pour étudier à Paris. Ce n’était pas du tout un coup de tête, parce qu’on s’est aperçu de ses efforts : il a appris le français, obtenu une bourse… Il est venu pour voir ce qui se passe à Paris, a été inscrit à l’École des Beaux-arts, mais sans être élève. L’idée de départ était d’y passer un petit temps. Après, il va passer sept ans à Paris avant de retourner en Inde. Dès qu’il aura plus de moyens, il retourne régulièrement en Inde. On peut dire qu’il n’a jamais quitté l’Inde. Quand on lit ses échanges, dans sa tête, il vit autant en Inde qu’à Paris. Dans ses carnets, vous avez le français, l’anglais et l’hindi. C’est très rare d’avoir une page où il n’y a pas les trois langues.
Son œuvre est traversée par un noir très profond – souvent appelé « couleur mère » dans la pensée indienne – et un rouge très lumineux. Est-ce que ce sont les deux couleurs clés de son œuvre ?
Il y en a plusieurs. L’Inde a des couleurs extraordinaires et des combinatoires de couleurs tout aussi extraordinaires. Mais le noir est quand même un élément très important, lié à certains symboles. Par exemple le noir du fameux cercle du bindu que vous voyez sur le front des femmes. Effectivement, il y a des moments, où il y a plus de rouge que d’autres. Dans la première partie, vous avez plus d’œuvres en écho à Nicolas de Staël, Bernard Buffet, avez certaines gammes de couleurs. Et à partir de certains moments où il commence à redécouvrir ou à regarder la miniature, les gammes changent, jusqu’à l’arrivée des ocres, des orangers… comme, par exemple, dans le magnifique Maa (Mère), le très beau tableau de 1981, qui n’a jamais été montré depuis qu’il a été acheté par une très bonne collection indienne.
La terre et la nuit figurent parmi ses thèmes de prédilection.
Raza connait parfaitement la mythologie, les grands livres indiens, mais aussi les textes coraniques, parce qu’il ne faut pas oublier qu’il est né dans une famille musulmane et que toute sa famille, sauf lui, est partie au Pakistan au moment de la partition. Il s’est également beaucoup intéressé aux grands textes du christianisme, ce n’est pas un hasard si on a toute cette série d’églises au début de l’exposition. Il est très au fait des textes sacrés. C’est là la subtilité, le grand art. Il associe cela à tout un processus de subjectivation par rapport à ses émotions, à son état psychique. C’est un homme qui a des moments d’extrêmes exaltations, des moments d’extrême mélancolie. Il condense tout cela dans des thématiques universelles, comme la nuit, la terre…
Après les paysages, les églises, les peintures figuratives, comment est-il arrivé à l’abstraction, au motif du bindu [« goutte », « point », « graine » en sanskrit] ?
Les premières années à Paris, il y a encore un rapport à certaines miniatures, le travail sur le corps, vous avez des paysages qui, peu à peu, deviennent abstraits, mais on voit encore des maisons, des lignes d’horizon. On voit un paysage qui est en train de se déconstruire. Après, il est tout à fait dans une abstraction très colorée. La couleur est aussi importante que l’explosion des formes. Et à partir d’un certain moment, au milieu des années 1970, son travail se concentre sur la méditation et la simplification. Il va élaborer un certain nombre de travaux à partir de figures et de signes géométriques très simples : le bindu, le signe du serpent. Il arrive à des compositions très simples, mais qui peuvent être très agitées par la couleur.
Beaucoup d’œuvres de cette exposition viennent de musées et de collections de l’Inde. Quelle est la réception de Raza en Inde ?
La dominante vient de collections indiennes. Nous avons fait notre mieux pour intégrer à l’exposition les quelques œuvres importantes qui, dans le temps, avaient acheté par des collections françaises, la majorité de l’exposition vient de collections indiennes. Maintenant, même les périodes École de Paris sont achetées par les Indiens qui avaient plutôt commencé avec la période « bindu » de la fin.
Il y a dix ans, à l’occasion de l’exposition Paris – Delhi –Bombay, le Centre Pompidou avait parlé d’une transformation en musée « globalisé ». Vous avez été directrice adjointe du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou et dirigé le service Recherche et mondialisation de 2014 à 2021. L’Inde, quelle place prend-elle aujourd’hui dans ce musée globalisé du Centre Pompidou ?
À mon avis, l’art moderne indien n’est toujours pas estimé. Là, je ne parle pas de mes collègues ou des gens qui ont compris depuis longtemps que c’est un des arts modernes les plus contrastés, les plus puissants. Le fait que la majorité de l’art indien est figuratif, pour moi, ce n’est pas un problème, mais pour certaines personnes, c’en est un. Il faut simplement avoir en tête que, quand vous voyez une forme humaine dans une peinture indienne, cela peut être une figure, cela peut être le portrait d’une personne, cela peut être un dieu, et cela pose des questions extrêmement intéressantes. Il y a beaucoup de choses à repenser. À commencer par le fait que ce n’est pas parce que cela est abstrait que c’est plus moderne, plus intelligent, plus progressiste, etc.
Beaucoup de grandes œuvres modernes indiennes sont en Inde. Il y a de très grands musées privés, comme le Kiran Nadar Museum of Art (KNMA) de Delhi, qui nous a prêté une vingtaine d’œuvres. Un des futurs possibles pourrait être qu’on s’échange des sections pour qu’on puisse voir les œuvres dans leur contexte, leur évolution, leur complexité, etc., et pas une œuvre en otage dont on ne sait pas d’où il vient et où il va… et qu’on puisse faire cela pour des périodes relativement larges. De toute façon, les très grandes expositions deviennent de plus en plus compliquées, vu le coût des assurances et les problèmes de transports. Et le but est d’intégrer au plus vite l’art moderne indien dans le grand corpus de l’art moderne du XXe siècle dont il est l’un des éléments majeurs.
► S.H. Raza (1922-2016), première présentation monographique de l’œuvre du peintre au Centre Pompidou-Paris, jusqu’au 15 mai.
► Le 3 avril à 19h aura lieu au Centre Pompidou la projection du film : S.H. Raza : The Very Essence, de Laurent Brégeat. Entrée libre.
► À lire aussi : Inde: la biennale d’art de Cochin, un espace de liberté artistique unique en Asie
► À lire aussi : Paris Photo 2022: Bharat Sikka explore l’identité de «l’homme indien»
► À lire aussi : Subodh Gupta: l’artiste indien entre Duchamp et Ai Weiwei
► À lire aussi : Paris-Delhi-Bombay, quand l’art contemporain joue à l’ambassadeur
► À lire aussi : Atul Dodiya: l’Inde, la France et les scribes de Tombouctou